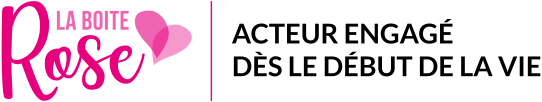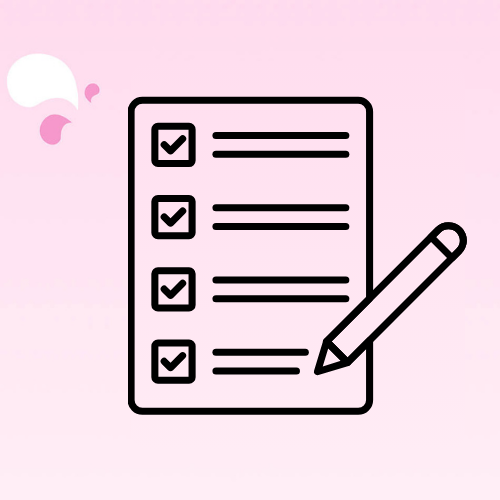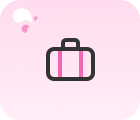Papas homosexuels : « tu ne dois pas expliquer ta famille à ton enfant »
Ecrit le 12/08/2022 par Eloïse Dohmen, Rédactrice et sophrologue
Pour un couple de papas, devenir parents n’est pas aussi évident que ça en a l’air. Il y a encore beaucoup de freins qui existent, en matière d’accès à la parentalité.
Qu’en est-il exactement ? Nous avons interviewé Nomi, de la Maison Arc-en-Ciel de Namur, afin d’en savoir plus à propos du quotidien et du vécu des papas homosexuels.

Profitez jusqu’à 600€ d'avantages, des conseils d'experts
de nombreux échantillons, des coffrets offerts, dites-nous où vous en êtes :
Qu’en est-il des rôles parentaux au sein d’un couple homosexuel ?
« La Belgique est parmi les premiers pays à voter le mariage homosexuel, en 2003. Et l’accès à la coparentalité, c’est en 2005. Et c’est un accès à la famille de manière plus traditionnelle. Parce que, des parents homosexuels, il y en avait bien avant ça, mais il n’y avait pas les mêmes droits (…).
On ne va pas parler uniquement du genre et du sexe, mais aussi du rôle parental. Dans un couple avec deux papas, ce n’est pas deux fois le même rôle parental. Les rôles parentaux sont répartis sur deux hommes.
Il y a toujours cette grosse phrase : « qui fait le papa, et qui fait la maman ? ». Et même si dans certains couples ça pourrait se reproduire, ce n’est pas à ce point caricatural.
Quand on dit « un couple avec deux papas », j’ai l’impression que ça génère cette confusion. De croire que c’est uniquement le rôle de père qui est dupliqué. Alors que ce n’est pas vrai du tout.
L’imaginaire collectif du mot « père » est ultra chargé. C’est quelque chose de très important, et c’est très dur de lutter contre. Parce que rien que le mot, ce sont des tonnes de stéréotypes qui sont évoquées. Peu de pères vont se définir comme une répartition des rôles entre deux personnes. Dans un couple de papas, c’est clair que la question se pose.
L’accès à la parentalité pour les personnes homosexuelles n’a, actuellement, pas permis de bouleverser les normes, la société en tant que telle, sur la vision de la parentalité. Ça a été fortement lié au droit, qui a été calqué sur un modèle hétérosexuel. Le rôle de la communauté LGTBQI+ est de remettre en cause la répartition sexiste des tâches. C’est une lutte contre le patriarcat (…). Il y a encore une certaine marginalisation qui a lieu, et il n’y a pas eu de renversement du système patriarcal. »
Comment est-ce que les enfants perçoivent cette situation ?
« Les enfants grandissent dans leurs normes. Tu ne dois pas expliquer ta famille à ton enfant. Ce qu’il faut expliquer, en fonction de l’âge, c’est l’homophobie, ou la transphobie, ou le rejet, ou la stigmatisation des autres. Les explications viennent de là.
Dire que l’enfant ne va pas subir de l’homophobie, indirecte, vis-à-vis de ses deux papas, ça serait naïf. Naïf de croire qu’aujourd’hui il n’y a plus de remarque, ni de stigmatisation. Dans la classe de ton enfant, il y a la relation avec les institutions de l’école (la direction, les instits…), il y a aussi les enfants, les autres élèves. Il y a l’homophobie par l’école, ou à l’école. Il y a les parents des autres enfants aussi. Ce n’est pas parce que ça se passe bien à l’école, que tu ne pourrais pas subir de l’homophobie à la sortie des classes, aux réunions de parents, ou aux anniversaires.
Donc, pour les couples de pères, une fois que tu as eu accès à la parentalité, il y a la vie de père face à la société. Une société dans une norme hétérosexuelle.
Ça peut aussi se matérialiser dans les activités qui sont proposées aux enfants. Il y a la fête des pères et des mères, qui est hyper classique. Mais aussi, quand ils apprennent à dessiner leur famille, parfois, tu dois faire ton arbre, avec les emplacements qui sont prévus, où tu dois juste mettre les prénoms en dessous pour ton papa et ta maman. C’est arrivé à des personnes proches de moi. Et la pluralité des parentalités, elle n’est jamais reconnue. C’est aussi le cas pour les familles monoparentales par exemple. Et chez les parents, c’est souvent leur légitimité qui est questionnée. C’est dire « l’autre maman » ou « l’autre papa ». Juste dire « l’autre », c’est déjà compliqué. C’est dur de ne pas se sentir légitime. »
Quelles sont les possibilités pour avoir l’accès à la parentalité, en tant que papas homosexuels ?
« Il y a l’adoption. Pour les couples gays, souvent, ce sont des adoptions intra nationales. Les pays qui permettent l’adoption n’autorisent quasiment jamais une adoption de deux pères. Chaque pays a des règles très strictes. Il y a des pays où tu dois être hétéro. Il y a donc peu de possibilités à l’international. Et ça limite quand même pas mal l’adoption. En soit, dans la loi c’est autorisé, donc les couples gays ont quand même accès à l’adoption. Mais c’est plus difficile.
Tu peux aussi adopter un enfant que tu connaissais. Par exemple, tu as un père célibataire, qui est en couple avec un autre homme : pour l’adoption ça ne pose plus de souci.
On a rencontré une personne dans ce cas la semaine passée : ils étaient famille d’accueil. Par exemple, dans la relation avec l’enfant au fil des ans, en tant que couple gay, tu peux adopter.
Il y a la GPA (Gestation Pour Autrui), qui n’est pas cadrée. C’est l’un des objectifs du mouvement gay, d’avoir accès à la GPA. Ce n’est pas simple, mais selon moi, au mieux c’est encadré, au mieux c’est pour tout le monde. Parce qu’alors, tu peux vraiment donner des droits à la personne qui porte l’enfant.
Il y a des réseaux de coparentalité. Il y a, par exemple, des hommes célibataires qui veulent s’investir dans un rôle parental, et qui, du coup, postent une annonce sur un réseau de coparentalité. Ce n’est pas une démarche facile. »
Nomi nous précise, aussi, qu’il existe d’autres possibilités, en fonction du couple. Dans le cas de couples lesbiens, ou de couples dont l’une des deux personnes est transgenre (ou les deux), la grossesse et la PMA sont également envisageables.
« Ce n’est pas parce que le droit est là, que d’office c’est facile. Ce n’est pas parce que c’est autorisé que c’est faisable dans la pratique. C’est le cas pour l’adoption. La stigmatisation et les préjugés sont encore présents. »
Quelles sont les aides qui existent ?
Nomi travaille à la Maison Arc-en-Ciel de Namur. Cet organisme rassemble un bon nombre d’associations LGTBQI+ de la Province de Namur, et s’occupe de sensibiliser aux enjeux de la communauté LGTBQI+. Des activités communautaires sont également organisées. Pour les personnes dans le besoin, en cas de difficultés de parcours par exemple, un accompagnement individuel est proposé. Ils apportent aussi une aide pour effectuer les démarches.
L’asbl Homoparentalités est une association spécialisée dans le domaine de la parentalité LGBTQI+.
Il existe aussi deux instituts fédéraux : UNIA et IEFH.
UNIA peut apporter une aide pour tout ce qui concerne la discrimination (entre autres vis-à-vis de l’homosexualité).
l’IEFH est spécialisé dans les questions de sexisme et de transidentité.